Zeitgeist, période, nationalité, tendance, parti pris, génération, et autres miroirs
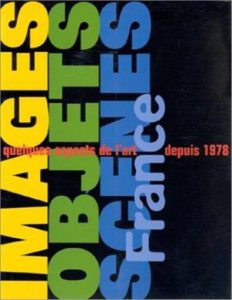
(Publié in cat. de l’exposition Images, objets, scènes – quelques aspects de l’art en France depuis 1978 (26 janvier-16 mars), Grenoble, Le Magasin, 1997, p. 12-29. — « Image(s) of the exhibition. Zeitgeist, period, nationality, tendency, parti pris (preference), generation and other mirrors », trad. en anglais Simon Pleasance & Fronza Woods, p. 30-47. — « Parodos vaizdas (ai) », trad. en Lituanien in cat. Vaizdai, objektai, scenos. Prancūzų Dailēs. Aspektai nuo 1978 ųjų metų, Vilnius, Šiuolaikinio meno centras/Prancūzų, Oskaro Milašiaus kulturos centras, 1997.)
« Faire le portrait de sa génération, voilà une belle ambition, et tout à fait irréalisable. Il est au moins permis de remplir quelques cartons avec des études crayonnées devant des paysages, et qui serviraient, espère-t-on, pour la grande fresque que nul jamais ne peindra. En tout cas, planter son chevalet en des endroits divers, crayonner avec curiosité et goût quelques figures, quelques perspectives, repérer sur une coupe indivisée de temps ces visages changeant qu’un Claude Monet abstrait d’une cathédrale ou d’un étang fleuri, voilà une occupation que par expérience je sais agréable, et que par illusion je me flatte parfois de croire utile »
(Albert Thibaudet [1])
On pourra toujours soutenir qu’une exposition n’est pas l’art, qu’elle n’en est que la retombée, la trace déposée au bord de parcours qui répondent à d’autres exigences, on ne fera jamais qu’elle ne se présente unifiée comme un texte, c’est-à-dire un ensemble signifiant, délimité et structuré, qui s’offre d’emblée comme un signe global. Iouri Lotman [2] remarque le caractère iconique du texte artistique. Ce trait, valable pour l’œuvre (au féminin comme au masculin), doit être transposé à l’exposition qui, prise comme ensemble clos, fait tout autant image. La différence d’une exposition de groupe par rapport à une individuelle ne tient dès lors pas tant au nombre d’acteurs en cause qu’à la façon dont elle renvoie une image construite sur celles, superposées, entrecroisées, déformées, d’autres miroirs antérieurs. Foncièrement déséquilibrée, boiteuse, elle fuit de toutes parts, a des contours flous. Des séries hétérogènes convergent pour faire sens autour de son centre aveugle. Elle comporte plusieurs pans avec des passages, comme une surface cubiste, qui offrirait à la réflexion (à tous les sens du terme) la possibilité de miroiter dans plusieurs directions. Appareil optique complexe et efficace, sa fonction essentielle consiste à disposer des configurations factices et à construire un effet de sens. Un tel dispositif, reposant sur une pluralité de miroirs tronqués, déformants, en tout cas mal ajustés, est fondamentalement commandé par l’imaginaire. Le caractère boiteux des images constitutives, leur inadéquation, engendrent le jeu infini du commentaire. Le titre, l’énoncé du concept ou du projet, l’unité de temps et de lieu de la manifestation, sa duplication dans le volume du catalogue, parent cependant au déséquilibre de l’édifice, et lui donnent son unité provisoire d’icône, sa façade imaginaire.
Ainsi en est-il de l’exposition images, objets, scènes qui porte, nous dit le sous-titre, sur quelques aspects de l’art en France depuis 1978. Le communiqué de presse tient 1978 pour une « date symbolique qui marque un redéploiement de la scène artistique française et des recherches qui s’y développent ». La référence implicite fait à travers cette date à une manifestation antérieure, non moins que l’amplitude périodique adoptée, enchaînent l’exposition à tout un jeu de miroirs discernables en arrière plan.
partis pris autres
1978 renvoie en effet, de l’aveu même d’Yves Aupetitallot [3], à partis pris autres, une exposition qui eut lieu à l’ARC, au Musée d’art moderne de la ville de Paris [4], et contituait le troisième volet d’un triptyque organisé dans le cadre du Festival d’automne de 1979, sous le titre générique Tendances de l’art en France 1968-1978/9. Les deux premiers volets, ordonnés respectivement par Marcelin Pleynet et Gérald Gassiot-Talabot, avaient entraîné la constitution du troisième, non prévu semble-t-il à l’origine :
« Le troisième volet a été conçu par certains artistes invités qui, mal à l’aise sous un patronage, ont préféré une absence d’étiquette – signe des temps – pour réunir autour d’eux d’autres créateurs liés par un même courant de pensée mais dont les pratiques sont individualisées en autant de partis pris – autre signe des temps. »
Suzanne Pagé, maître d’œuvre de l’ensemble, auteur des lignes qui précèdent, tentait dans la préface de dresser un bilan de la décennie précédente. Reconnaissant dans les sélections défendues par les deux commissaires susnommés des écuries largement picturales, elle notait cependant dans la deuxième, dominée par la peinture figurative, la présence de formes extra-picturales (Forest, Fischer, Journiac et Gina Pane), mais cette tendance, selon elle, était plus spécifiquement la marque des partis pris autres :
« Cette suppression définitive des genres ou catégories traditionnelles et leur contamination réciproque est caractéristique d’une part importante de l’art des dix dernières années, tel qu’il apparaît surtout dans le Parti Pris 3 “Partis Pris autres“ ».
En glissant du pluriel du sous-titre à une formulation au singulier, elle constituait un sujet collectif qu’elle rattachait à d’autres courants :
« Participant de l’Art Conceptuel sans doute, il s’inscrit plutôt dans l‘esprit de Dada et de Fluxus. Il s’emploie à réduire l’écart entre l’Art et la Vie […] tout un réseau occulte de stratégies fictives ou de faits souterrains, enfouis, oubliés, clandestins même, que l’on a parfois regroupé sous le générique des mythologies individuelles ».
Pourtant partis pris autres comportaient des peintres aussi bien que des tenants des mythologies individuelles. Mais tout se passe sous sa plume comme si leurs œuvres n’étaient pas vraiment commentées, étaient référées à un ensemble extra-pictural. Buren et Toroni certes présents, le cas de B.M.P.T. [5] a été réglé de façon lapidaire quelques lignes auparavant :
« La surenchère du Nouveau a entraîné sa faillite, rendant suspecte la notion d’avant-garde […] conduisant aux positions limites et contradictoires de la fin des années 60 : soit hypertrophie du pouvoir de l’art […] soit, au contraire, dépersonnalisation de l’art dans l’anonymat mécanique et nihiliste du tableau ramené à un support et une surface radicalement neutres (B.M.P.T.) »
Ceux qui donneraient la clé de l’ensemble seraient donc autres, à chercher parmi les artistes que Jean Clair, dès 1972, dans son livre Art en France – une nouvelle génération, classait dans la partie « objet » de la tranche « comportement », du camembert constellé d’artistes dont il avait orné la couverture (y figurent Boltanski, Le Gac, Poirier, Sarkis). Ou encore, les deux ensembles se recoupant, parmi ces artistes qui avaient vécu une sorte d’aventure collective à géométrie variable, entre 1968 et 1972, et que Jean-Marc Poinsot appelle l’« équipe Boltanski » (Boltanski, Borgeaud, Cadere, Gette, Le Gac, Messager, Pane, Sarkis) [6]. Est ainsi inscrit implicitement au creux de partis pris autres un miroir double, à la fois épopée collective particulière et sorte de version française de l’Arte Povera, miroir effacé mais encore actif qui vient ajouter sa teinte en sourdine sous celui que l’exposition tend en surface et où se reflète un front du refus.
Au moment même où venait de s’ouvrir Tendances de l’art en France, Bernard Lamarche-Vadel exprimait dans la préface du numéro 1 de la revue Artistes, une volonté similaire de revalorisation des démarches extra-picturales :
« Alors que la plupart des pays européens, depuis plusieurs années déjà, se sont engagés, de diverses manières, dans la présentation des courants non picturaux de l’art international, la France, sur ce point, accuse un singulier retard. »
Symboliquement, cependant, ce numéro comportait une étude sur Buren, Mosset, Parmentier et Toroni. Pareillement, dans le schéma topologique de Jean Clair, ces artistes n’étaient pas loin, du côté du vecteur « l’art comme concept ». Le front opposé à la tradition picturale française était encore uni. Dans la préface de Suzanne Pagé, comme dans celle de Lamarche-Vadel, on sent donc s’esquisser un gauchissement qui fait passer du front du refus au « reste » : ni peinture ni sculpture. La valorisation de ce dernier se renforcera au début des années 1980, par réaction au retour de la peinture. À Pierre et Marie (1983-1985), dont Buren et Sarkis entre autres furent commissaires, réunissait des artistes « à cheval ». Philippe Cazal, présentant en 1984 le premier numéro de la revue Public, y évoquait « des artistes contemporains libres des pratiques en usage, de la peinture et de la sculpture » qu’il tenait pour une « mouvance »… L’écho de ce gauchissement, la substitution du « reste » au « refus » se fait entendre dans la présente exposition qui, tout en ambitionnant de dégager les « axes essentiels qui permettent d’aborder l’histoire et le développement de la création artistique de ces vingts dernières années en France », ne retient que des artistes strictement ni peintres (Frize excepté) ni sculpteurs, et compte donc pour du beurre les Buren et Toroni. À cette première transformation s’en ajoute une seconde : certaines figures tutélaires que parti pris autre appelait, telle celle de Boltanski, s’effacent au profit d’autres – les Frize, Lavier et Vilmouth étant intronisés en position de parrains.
Identités
Les artistes de partis pris autres avaient fait imprimer leur propre préface dans le catalogue de cette troisième manifestation. Ils y évoquaient le « refus » pour certains d’entre eux « envers toute tendance à un quelconque regroupement de type hégémonique » :
« Exposition hétérogène : aucun des travaux présentés n’implique qu’il faille disposer une définition sur la nature de l’objet, voire la nécessité d’une telle manifestation. »
Suzanne Pagé, quant à elle, émettait l’idée qu’à chaque individualité correspondait un parti pris. L’idée d’un nouveau courant constitué d’individualités inclassables sera reprise par Claude Ginz dans son article « identités nouvelles » (pour le recueil collectif 25 ans d’art en France – 1960-1985) qui porte à peu de chose près sur la même liste d’artistes. En 1985 le premier numéro de la revue Des arts inscrivait en colophon de la seconde page de couverture une « assemblée de singularités face aux multiples interpellations de la « culture contemporaine ». La liste serait longue à dresser de ce genre de constat devenu un lieu commun :
« Aux découpages des avant-gardes ont fait place hétérogénéité et tendances à l’individualisation des pratiques. [7] »
La dénégation de toute appartenance à quelque école que ce soit, de toute filiation, est une figure de rhétorique suffisamment connue pour qu’il ne soit nécessaire de s’appesantir. Doublé du corollaire positif induisant qu’il y a autant de courants, de concepts, que de singularités artistes, l’énoncé remonte sans doute au début des années soixante-dix, où il sous-tend des recueils comme le Senza titolo de Germano Celant en 1974, qui ne comporte que des notices par artistes et aucun texte général, ou La Nuova Avanguardia de Grégoire Müller (1972). Ce dernier y déclarait :
« Così, ci sono tante visioni dell’arte, radicalmente diverse, quanti sono gli artisti qui presentati, e in tal modo il dialogo tra essi appare subito liberato dalle controverse di forme e di stile. C’è un filo nascosto nel loro approcio dell’arte e nella loro comprensione dei problemi contemporanei che mi permette di presentarli insieme. »
Il reconnaissait l’origine de cette nouvelle situation dans le livre Arte Povera de Celant et dans l’exposition When Attitudes Become Form de Szeemann. Le miroir semble ainsi ne pas vouloir en finir, remonter de citation en citation… Il trouve cependant son terme dans la dernière exposition mentionnée, en raison même de ce qu’elle formule dans son titre le parti pris de l’individualisation des partis pris. Ce discours est encore fortement présent dans la biennale de Lyon, en 1991, L’Amour de l’Art, une exposition de l’art contemporain en France, que les commissaires, Thierry Raspail et Thierry Prat ont conçue comme « un ensemble de projets et propos individuels, produits en totale autarcie et discutés pour chacun comme s’il s’agissait d’exposition personnelle et singulière », et pour laquelle chaque artiste a eu sa salle, qui plus est fermée par une porte.
Dans le premier numéro de Documents, Éric Troncy [8], juge obsolète cette biennale (et sa scénographie), comparée à celle contemporaine du Whitney Museum, à New York, qui démontre selon lui « l’abandon précisément de la routine d’une production de signes claire et autonome qui renvoyait l’art dans un champ hermétiquement clos ». Le Ready-made, écrit-il, est « une systématique de type publicitaire » :
« C’est l’œuvre d’art modélisée une fois pour toute, le signe identifiable approprié ou, pour faire vite, la survivance épuisante des “bandes de Buren”, des “empilements de Lavier”, etc. »
On toucherait ici au terme des années 1980, dans cette possibilité qui se fait jour de dépasser ces « identités nouvelles », productrices de « pièces » qui les avaient caractérisées – la « pièce » finie et personnelle étant attaquée à la fois par la multiplication des œuvres collectives et par l’esthétique du ratage [9].
La présente exposition grenobloise remet certes en scène des réalisations collectives comme Sibéria et Ozone ; mais au milieu d’œuvres implicitement classées par rubriques selon les salles, dont la plupart ont déjà été exposées, qui appartiennent pour certaines à des collections, ces réalisations collectives, ces expositions re-présentées sont absorbées dans un contexte de « pièces » qui, il faut bien le dire, ne renvoie guère l’écho de ce « passage des économies marchandes et économies du signe à une véritable esthétique de l’action » qu’évoque Éric Troncy dans l’article sus-cité. Les animateurs de cette nouvelle esthétique, qualifiée par Nicolas Bourriaud de « relationnelle [10] », se trouvent irrémédiablement pris dans la logique du nom propre, et des œuvres vendues et répertoriées. C’est là l’effet lénifiant de l’exposition historique, qui peut bien remettre en scène des installations, des performances, voire d’autres expositions, mais pas leur contexte redevenu celui du « champ clos de l’art », pour l’oubli réitéré de cet autre champ « ouvert, poreux et chaotique » que Troncy appelle de ses vœux. Sur ce point, la déformation opérée se fait au profit des années 1980, ou plus exactement de ce que l’exposition en reflète.
Art en France / art français
Les artistes de partis pris autres concluaient ainsi leur brève préface :
« Exposition qui tentera, dans tous les cas, de ne point identifier, s’approprier ou infléchir l’issue de la vie artistique des années qui précèdent, mais plutôt d’interroger, par le biais d’une présentation non préméditée, l’ensemble contradictoire, inachevé et ingouvernable que peut produire aujourd’hui une exposition collective à caractère national. »
La circonlocution « exposition collective à caractère national », plus qu’un effet de style, trahissait l’existence d’un problème qui dépassait celui de l’exposition en question.
Dans un entretien accordé à des étudiants rennais, critiquant le goût patrimonial du milieu artistique français, Yves Aupetitallot déclare :
« Je suis également frappé par la quasi absence d’expositions historiques et scientifiques dans les musées. Ce milieu est sans mémoire, sans repères, et se comporte en maniaque fétichiste. […] Ce milieu s’organise surtout dans un rapport de dépendance à l’État, aux collectivités locales et à leurs agents administratifs. Je ne crois pas que cette situation spécifiquement française puisse perdurer. Si avenir international il y a pour la création artistique française et le milieu français dans son ensemble, il me semble nécessaire de refonder sa hiérarchisation autour de l’artiste [11] »
La reconnaissance d’une création « française » et le rappel de la nécessité d’organiser des expositions historiques ne peuvent pas ne pas être rapportés à la présente entreprise, que cet entretien semble annoncer.
En intitulant une exposition Qu’est-ce que l’art français ? [12] Bernard Lamarche-Vadel renversait par provocation ce qui est devenu un lieu commun de la scène artistique française : la dénégation de toute appartenance nationale, son euphémisation dans l’appartenance à un simple lieu géographique (de résidence) auquel est refusé toute capacité d’engendrement culturel. Depuis l’exposition du Grand Palais en 1972, le livre de Jean Clair la même année et la suivante celui d’Anne Tronche, jusqu’au recueil collectif publié chez Larousse en 1985, et au livre de Catherine Millet en 1987 (réédité en 1994), on n’a guère que de l’art « en France » mais pas d’art « français ».
L’énoncé Il n’y a pas d’« art français » servit de titre à une exposition du Magasin, à Grenoble, en 1989. Il fallait l’entendre comme un prolepse, retournant l’argument de l’adversaire et permettant de conclure paradoxalement à l’existence de cet art :
« Certes il n’y a toujours pas d’“art français” au sens d’une école, d’un mouvement, d’un marché. Mais ce qui a été sa faiblesse est devenu sa force. Il fallait le dire. Il fallait le montrer. [13] »
Le catalogue, avec traduction en anglais, allemand, espagnol et italien, fut présenté à New York. On entendait bien cette fois faire la promotion dudit art. La co-organisatrice, Nadine Descendre, situait dès le début de sa préface l’enjeu au plan du marché et de l’exportation :
« un certain art français en tant que globalité intellectuellement et économiquement monnayable s’est trouvé en vacance de reconnaissance internationale »
Elle évoquait comme un groupe solidaire d’artistes « hors jeu » pratiquant surtout « l’individualisme » :
« Cette attitude s’est doublée toutefois d’une attention spontanée à des sensibilités d’artistes qui en étaient proches, en France et au-delà des frontières, les reliant les uns aux autres […] Ils ont, en étant complices, reconstitué de manière informelle une cohérence sans chef de file, une cohésion sans nom […] et donné tous les signes d’un esprit français original […] »
Suivaient des considérations sur cet esprit français, Descartes à l’appui :
« L’intérêt de cette production française, sa profonde singularité, résident dans une combinaison d’abstraction et de matérialisation, d’objectivité et d’expressivité, d’universalité et de localisme, d’expérimental et d’enraciné […] toute une génération d‘artistes français pour qui les principes du rationalisme ont gardé tout leur sens. »
Le mélange de philosophie péremptoire et d’arguments de marketing pouvait laisser pantois. Il n’en demeurait pas moins que l’entité « art français » accédait bel et bien de nouveau à l’existence ; le propos nationaliste, un temps conspué, n’effarouchait plus.
Tout un ordre du discours se profile derrière une telle entreprise dont l’écho ne peut pas ne pas s’entendre dans l’exposition d’aujourd’hui. Elle poursuit un débat interne à la scène française, qui remonte entre autres à cet événement traumatisant de l’attribution du premier prix de la biennale de Venise de 1964 à quelqu’un, Rauschenberg, qui n’était pas de l’École de Paris. Comme le remarque Catherine Millet [14], à partir de ce moment-là les « jeunes peintres de tradition française » disparurent des sélections internationales ; les avant-gardes ont eu raison du nationalisme. Organisateur de l’exposition Statements New York 82 – Leading contemporary Artists from France, Otto Hahn ne peut s’empêcher d’évoquer dans sa préface cet événement traumatique et l’accueil distingué que lui fit Françoise Giroud :
« C’est à montrer son cul à la fenêtre. »
Tout un ordre de considérations sur les raisons du désastre, celles de critiquer, celles de se flageller, celles d’espérer ou celles de contre-attaquer, s’ensuivirent, qui émaillent périodiquement l’actualité artistico-française. Le sujet incriminé se déplaçant de l’art aux artistes, de ceux-ci à l’État et aux institutions, à la critique et aux revues, ou encore à des entités plus impalpables comme l’esprit ou le goût français, chacun étant tour à tour pris à parti et sommé d’agir. Quand Jean-Louis Froment, commissaire du pavillon français, s’abstint en 1990 de présenter des artistes plasticiens à la biennale de Venise, la réaction épidermique d’un milieu qui s’estime en général mal défendu ne tarda pas à se faire sentir, et une pétition circula. Au début de l’année suivante, à l’occasion d’une exposition d’artistes français présentée à Toronto [15], Daniel Buren et Michel Parmentier firent figurer dans la partie du catalogue qui leur était respectivemment réservée un même texte, signé conjointement, où ils s’étonnaient d’être là et pointaient l’arbitraire de la réunion :
« L’idée d’une exposition de groupe est stupide quand le critère de sélection est la nationalité […] nous n’arrivons pas à comprendre en quoi d’autres critères seraient moins intéressants (tels l’âge, le sexe, la couleur de la peau ou des cheveux) […] être français dans ce domaine n’implique aucune communauté. »
Ils trouvaient les attitudes des autres sélectionnés « simples à appréhender (trop simples) et intimement médiocres », mais l’exposition intéressante :
« […] elle montre ce qui est nul et donne un bon reflet de cette démission internationale, et particulièrement française […] »
Ils déclenchèrent l’ire (silencieuse pour la plupart) de leurs petits camarades !
La tentative de Nadine Descendre, rare, il faut bien l’avouer, a cependant été reprise de l’extérieur par Eric Franz et Dieter Schwarz qui, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, adressèrent un salut à l’art français depuis la Suisse et l’Allemagne, et tentèrent d’en caractériser un aspect majeur, celui des stratégie fondées sur la répétition, en titrant leur exposition Liberté & Égalité [16]. L’année suivante, French Kiss, l’exposition présentée à Genève par Éric Troncy, tournait résolument le dos à cet ordre de préoccupations :
« Le Talk Show se conçoit d’ordinaire en direct, sur un plateau de télévision. Il n’assène rien qui soit historique, ou prétende l’être, rien de définitif, la pensée y est en perpétuel mouvement. […]
« Il serait vain de chercher dans French Kiss l’expression d’une tendance, ou l’apparition d’un groupe, puisque le seul objectif de ce plateau éphémère est la production d’un spectacle en direct […] [17] »
Un tel titre exprime nettement la transformation du caractère national en label digestible, dans un contexte artistique international cosmopolite et en voie de mondialisation. Ici-même, dès lors, l’ambiguïté est frappante. Quand le miroir identitaire de la culture nationale semble ne plus briller que dans la parodie, l’institution qui propose une « redécouverte de la création artistique française » semble encore croire aux vertus de l’épithète.
Période
Qu’est-ce qu’une période ? Je lis dans le communiqué de presse qu’il s’agit d’ « approcher l’histoire et le développement de la création artistique de ces vingts dernières années ». La présente exposition n’eut d’abord pas de titre. Il fallut pour communiquer recourir à quelques périphrases. Un artiste me dit au téléphone « Ah oui, l’exposition sur les années 1980 ! ». Quant aux œuvres ci-incluses, elles s’échelonnent à peu près sur une décennie, entre 1984 et 1994. Le caractère flottant des limites temporelles est frappant. Comme si le miroir périodique se trouvait doté d’élasticité.
La décennie est une catégorie rarement interrogée. Elle constitue le cadre temporel de partis pris autres, comme d’un nombre considérable d’expositions, avec la belle évidence des choses qui vont de soi. Il n’y a bien entendu rien de plus arbitraire ; on ne voit pas pourquoi l’histoire serait réglée comme du papier à musique et changerait de cap mathématiquement tous les dix ans, tous les cent ans. Il y a ainsi les années 1980, comme il y eut les années soixante-dix et toutes les autres décennies dont on tire immanquablement de beaux albums illustrés à parution programmée pour les étrennes.
Voici près de dix ans, à Beaubourg, on avait emprunté à Baudelaire le titre d’un grand bilan international, L’Époque, la mode, la morale, la passion, qui couvrait la même période ou presque (1977-1987). Thierry de Duve avait imaginé à cette occasion un dialogue entre Achille et la tortue :
« Achille : Le temps presse.
La tortue : Mais non.
A. Il faut partir du titre.
[…] T. La mode est le seul mot important dans ce titre. Il dit la vérité des autres.
A. Je ne suis pas satisfait.
T. Moi non plus. Mais l’époque on ne peut pas en parler.
A. Pourquoi pas ? Nous sommes là pour ça.
T. Parce qu’on ne peut parler d’une époque que quand on en est sorti. Nous sommes toujours dedans.
A. C’est pourtant une rétrospective. On fait le bilan.
T. Une rétrospective arbitraire, le dixième anniversaire de Beaubourg. On ne périodise pas l’histoire à coups d’anniversaires.
[…] C’est le problème avec les institutions, elles veulent faire l’histoire à la place des artistes […] [18] »
Du reste de la discussion il ressortait que la périodisation à chaud plaçait le commentaire critique plutôt du côté de l’artiste que de l’historien. Achille et sa commère débattaient ni plus ni moins d’un problème d’optique : la tortue tenant la distance (temporelle) du point de vue pour garante d’une bonne profondeur de champ (périodisation).
Zeitgeist
Une exposition berlinoise, en des temps de retour triomphant de la peinture, avait fait auparavant plus court avec Zeitgeist. Le bilan décennal n’est en effet rien s’il ne parvient à énoncer l’esprit du temps – à plus forte raison s’il s’agit d’un bilan national qui prétend à une portée plus large. Sous l’idée de décennie, il ne faut pas bien gratter pour retrouver une esthétique historiciste qui vient de l’École de Vienne, de Riegl, de Dvorak, et pour laquelle le Kunstwollen se manifeste dans toutes les œuvres d’une époque, exprime l’attitude philosophique de son temps. Pour une telle pensée il n’y a pas des groupes, des mouvements contemporains et concurrents, mais de vastes courants, des crues qui se succèdent et témoignent de changements historiques plus profonds. À la profondeur de champ s’ajoutent ici des considérations sur le cadrage qui doit être en somme suffisamment large pour englober toute la coupe pratiquée dans une époque.
Faisant dès 1984 le bilan du début de la décennie, Catherine Strasser évoquait un « phénomène artistique [qui] ne se livre pas sous la forme d’un mouvement organisé, avec ses manifestes et ses théoriciens, mais plutôt comme la coïncidence d’une série d’événements singuliers ».
« Les analyses classiques, qui veulent que les configurations artistiques obéissent dans leur succession à une logique évolutive linéaire et qu’elles soient par conséquent, toujours une réaction à ce qui les a précédées, se sont trouvées confortées par l’apparition quasi simultanée de situations comparables en Europe et aux États-Unis, et par les divers commentaires qui les ont escortées. Plusieurs manifestations d’envergure internationale ont ponctué, enregistré, puis institutionnalisé le courant pictural figuratif. [19] »
Suivait l’évocation de ces manifestations dont la liste – Après le classicisme (Saint-Étienne, 1980), A New Spirit in Painting (Londres, 1981), Baroque 81 (Paris, 1981), Zeitgeist, etc., est bien connue, ainsi que celle des mouvements princeps tels la Transavanguardia, les Neue Wilden, la Pattern Painting, etc. Elle ajoutait une prudente réticence : la situation française n’offrait pas selon elle le caractère de réaction à la domination de l’Arte Povera et du minimalisme dans les autres pays : « La France a toujours vu cohabiter […] des tendances extrêmement hétérogènes ». Le chapitre qui clôt le recueil collectif de 1986 sur 25 ans d’art en France, n’en porte pas moins essentiellement sur des peintres figuratifs.
Oublions ce genre de coquetterie qui veut masquer ce qui se donnait justement comme un raz de marée, une force. Chez les révolutionnaires allemands du tournant du dix-huitième et du dix-neuvième siècle, Zeitgeist « désigne une force irrésistible dont l’avancée renversera tous les obstacles institutionnels [20] ». Le Zeitgeist des années 1980 a d’abord été porté par une puissante mythologisation du peintre (ou du sculpteur) traditionnel. Pour Christos Joachimides, cette figure signifiait à nouveau l’Art :
« Zeitgeist ist ein Ausstellung von fünfundvierzig Künstlern – Malern und Bildhauern. Malerei und Plastik – diese ältesten Kunstdisziplinen – transportieren heute wieder bei weitem die wichtigsten kreativen Vorstellungen der Künstler. Und zeitgeist ist der titel dieser Ausstellung. Eine Metapher für all die künstlerischen Vorschläge von heute, die eine tiefgreifende Veränderung in der bildenden Kunst signalisieren. Die unmittelbare sinnliche Beziehung zu den Kunstwerken wird gesucht. Das Subjektive, das Visionäre, der Mythos, das Leiden, die Anmut sind aus der Verbannung zurückgeholt. [21] »
En 1987 Catherine Millet terminait son livre en disant son trouble :
« Au début de ce chapitre, j’ai annoncé le retour de la peinture. Eh bien j’ai en partie menti. Ou plutôt, j’ai accepté, comme beaucoup d’autres parmi le public et les professionnels de l’art contemporain, de jouer le jeu un moment, de faire semblant d’y croire. […] C’est comme si [les artistes] ne parvenaient pas à se décider entre le plaisir retrouvé de la peinture et la poursuite des spéculations avant-gardistes qui minent la peinture. Les francs-tireurs ont laissé la place aux agents doubles. »
Les bilans changent et ne se ressemblent pas. C’est ainsi qu’à Meymac, aux années soixante-dix, qualifiées d’« années mémoires », a succédé Un art de la distinction, ou que l’art américain sous Reagan (1980-1988) est A forest of Signs [22]. S’était-on auparavant trompé de Zeitgeist ? Qui dit la vérité ? Qui ment ? Dans sa présentation de l’exposition C’est pas la fin du monde ! (Rennes, 1992), Jean-Marc Poinsot se moque rétrospectivement des tenants d’un Zeitgeist en forme de retour :
« La génération apparue sur la scène artistique dans la seconde moitié des années soixante est aujourd’hui reconnue comme ayant posé les bases de ce que l’on a qualifié depuis de post-modernisme dans les arts plastiques […] ces artistes ont laissé le champ libre à une dramatisation de la fin de l’ère moderne […] On a alors prétendu que la peinture, l’image, la capacité expressive de l’artiste pouvaient ensemble fournir une alternative à des pratiques artistiques sans métier, sans âme et en marge de la société par leurs dimensions critiques et politiques. Or, la thématisation de la fin du modernisme […] a fait long feu. Il est clair que le retour à l’ordre qu’annonçaient la trans-avant-garde, le néo-expressionnisme et des expositions comme A New Spirit in Painting […] n’a pas eu lieu. [23] »
L’erreur de Joachimides, et de quelques autres, était sans doute d’être juge et partie, promoteur d’une tendance auto-déclarée comme esprit de l’époque. Le procédé appartient aux ficelles bien connues de la critique promotionnelle, qui avance masquée en manipulant le discours de l’histoire, sur le mode du « ce n’est pas moi qui vous dit que ça me plaît, c’est un phénomène naturel, voyez avec quelle force il nous submerge ». Qui nous dit que le Zeitgeist des années 1980 énoncé aujourd’hui avec à peine plus de recul, ne s’avance pas pareillement avec le masque de l’histoire, n’est pas pareillement un discours promotionnel, un miroir tendu pour qu’y brille une embellie présente, un miroir trop pressé, peu fiable ? Question de distance, de cadrage et de profondeur de champ dont décidément il est bien difficile de sortir.
Post-modernisme
« Images, objets, scènes » ne renvoie à aucun médium déterminé. La visite de l’exposition donne au contraire l’impression d’un univers sémiotique foisonnant : A Forest of Signs.
Dans l’article précédemment cité, Jean-Marc Poinsot remarque quant à lui qu’« au cours des années 1980 nombreux sont les artistes qui ont pris l’habitude de tenir des discours complexes avec des matériaux sémiotiques hétérogènes ». (Ce que Rosalind Krauss avait exprimé en ces termes en 1978, à propos de la sculpture :
« For, within the situation of posmodernism, practice is not defined in relation to a given medium – sculpture – but rather in relation to the logical operations on a set of cultural terms, for wich any medium – photography, books, lines on walls, mirrors, or sculpture itself – might be used. [24] »)
Puis, se référant à un fameux article de Craig Owens paru en 1980 dans October, il rappelle ce que cet auteur met sous la notion d’allégorie, emblématique selon lui du post-modernisme.
« Allegorical impulse is appropriated imagery ; the allegorist does not invent images but confiscates them. »
« Appropriation, site specificity, impermanence, accumulation, discursivity, hybridization – these diverse strategies characterize much on the art of the present and distinguish from its modernist predecessors. They also form a whole when seen in relation to allegory, suggesting that posmodernist art may in fact be identified by a single coherent impulse […] [25] »
Pour conclure il dénie « tout modèle de récit historique » au panorama rennais des années 1980, en faisant appel à Umberto Eco, lequel a écrit :
« Je crois […] que le post-moderne n’est pas une tendance que l’on peut délimiter chronologiquement, mais une catégorie spirituelle, ou mieux un Kunstwollen, une façon d’opérer. On pourrait dire que chaque époque a son post-moderne, tout comme chaque époque aurait son maniérisme […] »
Si l’on comprend bien la démonstration, les notions de post-modernisme et d’allégorie seraient donc des sortes de catégories trans-historiques, un peu à la façon de celles de Wölfflin. On concède que certes le post-modernisme correspond à une mode et qu’il apparaît comme tel à la fin des années soixante-dix ; mais on remarque aussitôt qu’on peut en faire remonter l’émergence avant. On absorbe alors le post-modernisme de la fin des années soixante-dix, dont la marque est le retour (retour à la peinture, au métier, aux styles traditionnels en architecture, etc.), en un autre plus vaste : – Steinberg ne parle-t-il pas déjà de « post-Modernist painting [26] » dans une conférence de 1968 ? – Duchamp, Picabia, ou de Chirico ne sont-il pas déjà post-modernes ? De là à penser que le post-modernisme transcenderait l’histoire, le pas est vite franchi. Là où le bât blesse, c’est que cette façon de transcender l’histoire est bel et bien datée. Quant à la référence de Eco au Kunstwollen, il semble ignorer que ce concept a été avancé en Allemagne dans le cadre de l’élaboration d’une Kunstwissenschaft distincte de l’esthétique (et de ses catégories).
D’autres tentatives pour poser des catégories trans-historiques ont été faites. Le maniérisme, que cite Eco, a été mis en avant par Achille Bonito Oliva pour caractériser la Transavanguardia [27], dans un livre où il reprend entre autres les idées d’hétérogénéité des signes et de cleptomanie. La fortune de la « simulation », popularisée à compter de 1981 par le livre de Jean Baudrillard [28], reprise un peu partout bien au-delà des simulationnistes américains, n’est pas moindre. Il n’y a rien qui ne puisse si bien se dater que les retours qui ont marqué le tournant de 1980, et le Zeitgeist, de Joachimides n’y échappe pas. Le post-modernisme, le maniérisme et la simulation, autres dénégations de l’histoire, non plus.
Une forme majeure de cette dénégation s’exprima également vers 1978-79 dans le No Future des Punks. Le mot d’ordre a été de nouveau mis en avant il y a peu par l’un des défenseurs des artistes les plus jeunes de l’exposition.
« La génération qui émerge aujourd’hui est la première à travailler dans le contexte d’une faillite des idéologies artistiques (no future) comme dans la banalisation et la prise en charge absolue de l’art contemporain […] La forme même des œuvres souvent résolument minable, imparfaite, volontairement ridicule mais sans cynisme […] semble indiquer le désintérêt manifeste de “faire œuvre” ou pire, de “faire de l’art”, et la préférence d’un espace précisément instable. […] [29] »
Le thème revient donc : « la fin de l’histoire » selon Francis Fukuyama [30] faisant écho en 1992 à la « fin des grands récits historiques » analysée par Lyotard [31] en 1979. Sur ce point force est de constater que l’institution (payée pour ça, mais après tout est-ce un mal ?) s’acharne à tendre un miroir historique à une génération qui se mire plus volontiers ailleurs, dans celui sans tain de l’absence de vecteur. Il est vrai que l’historien n’est pas obligée de croire que l’histoire s’est arrêtée avec l’effondrement du communisme !
Générations
Plusieurs générations se côtoient dans l’exposition : les activités de Présence Panchounette et Bertrand Lavier remontent au début des années soixante-dix ; Bernard Frize et Jean-Luc Vilmouth étaient parmi les jeunes de partis pris autres ; une majorité d’artistes déjà actifs au milieu des années 1980 constitue le gros des troupes ; une dizaine cependant n’est apparue que vers la fin de cette décennie. Le titre, images, objets, scènes, dit la raison d’être de leur réunion, pourquoi deux de cette génération, dix-huit de cette autre et dix de cette dernière (je compte en gros) ; il dit la solidarité des générations.
Reste à trouver ce qui relierait les thèmes retenus, ce qui expliquerait la solidarité de ces artistes. La réponse en boucle consiste à dire que ce sont des thèmes partagés par une même génération, appartenant à une même tranche de temps. Le poids de la dernière génération présente dans l’exposition fait basculer le propos historique du côté de l’actualité. On disait il y a quelques décennies « l’art vivant », ou encore « l’art d’aujourd’hui », on dit plutôt aujourd’hui « l’art contemporain ». « Le jeune homme, stade de l’homme jeune, est une création des temps modernes », disait Henri Lefebvre. La jeunesse post-moderne : voilà un beau thème moderne ! Il faut donc montrer la Nouvelle vague [32], les Nouveaux Francs [33]. La thématisation en tendance de cette contemporanéité relève du coup de l’exercice d’équilibriste. À moins de faire comme Thierry Raspail qui, au lieu de nommer les derniers labels, s’était résigné à dresser la liste de son Top 50 [34]. C’est que les derniers disques y figurant n’ont rien d’autre en commun que d’être les derniers en date à l’applaudimètre.
Yves Aupetitallot ne distingue que deux générations, celle des artistes qui avaient trente ans en 1978 et celle de ceux qui en ont trente aujourd’hui. La première, vue de l’étranger, a pu être nommée Post-Beaubourg Generation [35] En décalant un peu l’âge, et en mettant l’accent sur l’effervescence institutionnelle du milieu de la décennie, on pourrait aussi parler d’une génération Jack Lang… Au jeu des générations, le miroir souffre cependant de strabisme divergent. Si l’on lorgne du côté des Frize, Lavier, Panchounette et Vilmouth, on les trouve gratifiés par le coup de jeunesse que leur apporte la cohabitation avec les nouveaux venus : – pas si vieux les vieux ! encore d’actualité ! Si l’on se tourne résolument vers la jeunesse, les rôles s’inversent, et ce sont les anciens qui viennent la légitimer de leur poids et de leur reconnaissance. Le miroir des générations est ainsi tendu entre les deux termes. Au détriment du Marais, car à ce jeu la masse des artistes qui occupent le centre en est plus ou moins réduite à jouer les figurants. Le miroir des générations regarde sur les bords. Mais n’avons-nous pas eu l’occasion de lire sous la plume des Lacan et autre Lyotard l’éloge du regard latéral ? Ce qui signifie aussi que le point focal reste aveugle.
Scènes
Le titre se ressent d’un certain déséquilibre. « Images » et « objets » renvoient à des modes d’expression, mais « scènes » ? On aurait ajouté « installations », la liste aurait été homogène. « Images, objets, scènes », c’est une peu comme crayon, stylo et bureau, ou clou, vis et établi. « Scènes » introduit dans la sélection un critère d’un autre niveau.
Le mot vient de toute évidence de l’exposition précédente que le Magasin a consacrée à l’œuvre d’Allen Ruppersberg.
« Dans un ensemble de notes réunies en 1984 sous le titre Fifty Helpful Hints on the Art of the Everyday, Allen Ruppersberg qualifie ses œuvres de “scènes” : “ Il y a un moment dans chaque histoire qui demande une certaine scène pour pouvoir continuer. Chaque œuvre cosntitue une telle scène.” La remarque énonce la relation particulière que chaque pièce du travail entretient à l’ensemble de l’œuvre et laisse entendre que l’artiste […] considère moins son travail en termes de production d‘objets indépendants les uns des autres que comme des fragments, des actions partielles situées dans une œuvre comparable à un texte. [36] »
Yves Aupetitallot, dans sa préface vente l’actualité de cet artiste dont l’œuvre s’est développée dans les années soixante-dix. Il mentionne « toute une génération d’artistes qui, en même temps que Paul MCarthy, voit en lui un possible précédent anticipateur de pratiques les plus contemporaines » ; il cite notamment Dominique Gonzalez-Foerster et Philippe Parreno. Le terme « scènes » se situe du côté d’un partage qui recouvre celui des générations présentes dans l’exposition, « images » et « objets » allant davantage aux années 1980.
« Scènes » peut cependant être aussi entendu au sens de scène artistique. De telles scènes ou plutôt des réseaux émergent en effet de la liste d’artistes. Ils se recoupent parfois. Donnons leur un nom pour faire vite. Le premier le plus important serait le groupe Aupetitallot, du nom du curator qui, successivement, à l’A.P.A.C. à Nevers, puis à Saint-Étienne, à la Maison de la culture, en a montrés les membres, à savoir : Aubry, Bazile, Bourget, Bustamante, Duprat, Frize, Lavier, Leccia, Lévêque, Présence Panchounette, Séchas, Thomas, Vieille, Vilmouth. Le second serait le groupe Grenoble issu de l’école des beaux-arts de la ville où se sont rencontrés maîtres – Frize, Vilmouth, Leccia, Tosani – et élèves – Geoffroy, Gonzalez-Foerster, Joseph, Joisten, Joumard, Negro, Parreno. Le troisième, le groupe Troncy, porte le nom du successeur d’Yves Aupetitallot à l’A.P.A.C. On y trouve les artistes qu’il y a invités ainsi que ceux qui ont participé aux expositions dont il a été le commissaire [37] : Séchas, Gonzalez-Foerster, Huyghe, Joisten, Joseph, Parreno, Veilhan. (On aurait pu aussi l’appeler Documents du nom de la revue [38] où leur travail est souvent médiatisé. On aurait alors inclus les Hybert, Devautour, Bazile, Lavier…).
D’autres rencontres, certaines à l’occasion d’expositions de groupe, indiquent des lignes de solidarités, complémentaires de celles qui tournent autour de la personne du commissaire et de la scène grenobloise. Lavier et Panchounette étaient chez Éric Fabre. Lavier, Frize, Vilmouth ont vécu l’épisode (l’aventure ?) de partis pris autres. IFP, Thomas, Ernest T ont étés défendus par Ghislain Mollet-Viéville ; Aubry, Duprat, Séchas par Jean-François Dumont ; Cazal et Vilmouth ont eux-mêmes organisé des expositions réunissant certains des protagonistes [39] ; etc. La liste complète de ces rencontres démontrerait qu’au cours des années 1980 le « redéploiement de la scène artistique française » est dû en partie à la multiplication des occasions d’exposer, à l’activité des institutions, aux financements publics. Ce que Nadine Descendre appelle la « cohésion sans nom » des artistes français doit beaucoup à tout cet appareil producteur de visibilité.
Les liens qui unissent les artistes ne sont pas formalisés, certes, mais une sorte de solidarité opérationnelle s’est développée à travers l’ensemble de leurs aventures collectives. Cette solidarité informelle passe par un certain nombre d’agents, qu’incarne ici Yves Aupetitallot, lesquels agents du reste ne sont pas que des curators, mais aussi des critiques, des conservateurs, des directeurs de centres d’art, des revues, des écoles, etc. À cet égard, les années 1980 se sont prêtées à la vérification de la thèse du sociologue américain Howard Becker, qui a parlé le premier d’une solidarité des différents acteurs à l’intérieur de mondes de l’art plus ou moins concurrentiels.
Le miroir tendu par les scènes éphémères, les réseaux changeants que l’on pressent, implicites sous la sélection de cette exposition, renvoie l’image de cette solidarité opérationnelle qui a lié jeunes et vieux pour une ou plusieurs aventures. La présente exposition, quant à elle, fonctionne comme une cause momentanée, dont tous les acteurs sont peu ou prou partie prenante – dans la mesure où ils peuvent s’identifier dans le miroir, y trouver un sens gratifiant, se reconnaître dans le triple énoncé images, objets, scènes comme dans une sélection et une lecture de l’histoire de l’art français qui soit porteuses. L’exposition, loin de figer des scènes, loin de ne représenter que l’histoire de réseaux ou de groupes passés, les reconfigure, en renouvelle la performance. C’est qu’elle est elle-même une scène, un nouvel acte joué.
Aspects
Le titre de la présente exposition se démarque de celle de 1980 à l’ARC de deux façons : la référence à l’art en France est placée en sous-titre ; quelques aspects remplace tendances, gommée sans doute pour son côté tendancieux ! Ce sous-titre avoue prudemment que la sélection laisse un reste : les autres aspects. Il pare d’une certaine honnêteté l’organisateur, un organisateur qui ne trompe pas, ne camoufle pas un choix restreint sous un panorama prétendument général, ne fait pas croire à une exhaustivité absente, affiche clairement son parti pris – l’adjectif indéfini « quelques » ajoutant même une note de modestie.
« Quelques aspects » rend l’approche aimable, légère : comme une ambiance brossée à petites touches. Ne serions-nous pas invité à subir agréablement le charme de ce type de portrait impressionniste qu’évoque Albert Thibaudet dans le texte placé en exergue ? Nul contrainte ne serait imposée au spectateur-promeneur, invité à papillonner d’une scène à l’autre. L’affirmation de ne traiter que quelques aspects avec un air de ne pas y toucher, euphémise ainsi puissamment les partis pris qui sous-tendent l’exposition.
On s’est donc gardé de lexicaliser aucun parti pris, aucune tendance, a fortiori aucun Zeitgeist. Une telle prudence se détache sur fond des tentatives (évoquées précédemment) qui y échouèrent. Nous sommes loin des puissances mythologisantes, des professions de foi, du lyrisme prophétique. À côté de A Forest of Signs ou même, tout récemment au Magasin, de Cosmos des fragments futurs [40], le laconisme du titre ne peut que frapper. Comme si l’institution peinait quelque peu aujourd’hui à brandir un miroir glorieux et reluisant.
Tendances
Une lecture de l’histoire est toujours rétrospective. Le communiqué de presse de images, objets, scènes, tout en proposant une vision historique, celle des « axes essentiels qui permettent d’approcher l’histoire et le développement de la création artistique de ces vingts dernières années en France », se termine de façon symptomatique par l’évocation de sa « situation » présente :
« “L’architecture et son décor”, “l’artiste qui se met en scène lui-même”, “l’artiste qui met en scène son milieu”, “les images cachées”, “l’objet et son quotidien”, “l’effet mise en scène” sont autant de clés proposées pour comprendre l’évolution et la situation de l’art contemporain en France. »
Derrière cet aveu de l’actualité du propos s’entr’aperçoit ce qui se tisse entre passé, présent et avenir. Quelque chose résonne dans le mot « aspects » qui n’est pas un prudent impressionnisme à la Thibaudet. « Aspect », dit mon dictionnaire de linguistique, est une catégorie grammaticale qui exprime la représentation que se fait le sujet parlant du procès exprimé par le verbe, c’est-à-dire la représentation de sa durée, de son déroulement ou de son achèvement. « Depuis 1978 » indique ainsi une action qui continue au point où est situé celui qui parle ; le verbe appelé a la forme du non-accompli ou imperfectif présent. La question est laissée en suspens de savoir quand l’action intentée sera éteinte.
« Depuis 1978 », en laissant la période ouverte, introduit un fort vecteur. Enregistrant l’orientation d’une tendance, le miroir constatif la reflète en direction de l’avenir, vectorise le temps. Il reflète selon une perspective et il ouvre, trace une perspective. Ce double caractère perspectiviste se dévoile si l’on met en rapport les rescapés de partis pris autres avec les artistes les plus jeunes. Un fort vecteur anime alors l’exposition, des vétérans Frize, Lavier et Vilmouth à Parreno et consorts, découpant dans le continuum de l’art en France un ensemble orienté. Le titre ahurissant d’une exposition qui eut lieu à Nice en 1978 : D’hier à demain 1968 1978 1988 Un aspect de l’art actuel [41], trahissait ce rêve toujours sous-jacent de prédire l’avenir en écrivant l’histoire. Détecter une tendance, c’est toujours peu ou prou pointer le doigt en avant. C’est tendre un miroir qui réfléchi une configuration prémonitoire. Dans l’exposition grenobloise, on l’a quelque peu installé en contrebande.
Parti pris
Du choix déterminé de trois aspects, images, objets, scènes, nous n’avons pas la raison qui les lient. Ils se posent dans l’évidence. Ils ne se discutent pas. Pourquoi pas d’autres aspects ? – Par goût. Il ne peut y avoir d’autre raison que le goût, car le goût ne se discute pas. – Pourquoi avez-vous choisi ces aspects ? – Parce qu’ils me paraissent ne pas souffrir de discussion. Affirmation d’un parti pris sans commentaire. L’absence d’argumentation suppose que l’entente s’en passe. Le caractère lapidaire de l’assertion instaure tout un jeu d’inclusion et d’exclusion : il y a ceux qui acceptent l’évidence posée, participant du coup au consensus qu’elle appelle, s’incluant dans le groupe qu’elle fonde, et ceux qui attendent des explications et se placent de facto en position d’idiotes extérieurs au groupe.
Le caractère incantatoire, de l’entreprise se sentait bien sous la plume de Nadine Descendre. L’enjeu se situait clairement pour elle à l’échelle d’une économie nationale. Soit à déclarer dans un premier temps que les artistes français sont mal défendus, qu’on sélectionne de mauvaises listes, que l’on a une vision erronée de cet art, etc. Dans un deuxième temps on sort du chapeau une autre liste. Le lecteur-spectateur n’est en général heureusement pas regardant à l’argumentation ! Voici ce que cela donnait dans le texte de Lamarche-Vadel précédemment cité, avec à la différence de celui de Descendre, une dénégation de l’institution intronisante :
« […] la France elle-même méconnaît l’histoire et l’actualité des normes et n’identifie pas ses meilleurs artistes, préférant beaucoup soumettre à l’hommage public les voies régressives de l’appropriation instantanée d’un patrimoine sur lequel s’accumulent contrefaçons et mimiques. Au scandale du goût réactionnaire français, animé du goût sincère de servir notre pays et de servir du même coup l’altitude du génie européen, j’ai voulu opposer un acte exemplaire de sélection intransigeante d’individualités dont l’existence est vraiment consacrée à une grande idée, inéchangeable, inhumaine, et souveraine de l’art, c’est-à-dire consacrée à la fois à la transcendance du sens et l’exigence de la liberté, sans souci aucun d’être admis dans le cercle vicieux des significations instituées. »
Dans tous les cas, sous le discours de l’historien, celui purement performatif de la critique. Lamarche-Vadel, d’ailleurs, voyait dans le critique (lui-même) un « expérimentateur prophétique ». On n’est pas loin de la selffulfilling prophecy dont parlait Daniel Boorstin à propos de l’image publicitaire et de ses agents :
« Tentés, comme aucune génération ne le fut avant nous, de croire que nous pouvons fabriquer notre expérience – notre actualité, nos célébrités, nos aventures et nos expressions artistiques – nous finissons par croire que nous pouvons aller jusqu’à fabriquer l’étalon auquel nous pouvons mesurer tout cela [42] ».
Le miroir tendu au nom du parti pris est bien plus que celui d’une défense militante d’une cause bafouée. Il est en forme de toboggan. La glissade, partant du discours historique, franchissant allègrement les bosses du découpage en période et de la détermination du Zeitgeist, n’a pas besoin de rester longtemps dans le coude de la critique, car la planche à bascule des tendances, ou celle savonnée de l’art français font immanquablement atterrir dans le bac à sable de la publicité.
Zeitgeist 2 : images, objets, scènes
Les deux premiers termes accolés, « Images, objets », définissent une sorte d’univers Pop, sans que l’on sache très bien d’ailleurs s’ils désignent des savoir-faire, des genres artistiques, ou s’ils se rapportent au monde. La citation baudelairienne, en évoquant l’époque et la mode, situait pareillement le Zeitgeist, au moins autant dans la réalité que dans l’art. Car cette duplicité anime tout discours sur l’esprit ou l’air du temps. C’est ainsi que si l’on veut planter le décor des années 1980, on peut dresser deux listes parallèles des modes mondaines et artistiques. La première commençe alors avec quelques choses comme le Palace ou les Bains-douches, la seconde avec la Transavanguardia ou les Neue Wilden [43]. Depuis le début des années soixante avec le Pop Art, on a appris que les deux listes pouvaient se télescoper. Le mot même de Pop Art – c’est là son génie – joue en effet de la confusion entre deux niveaux : comme si, entre le réservoir hypotextuel que constitue l’espace mondain et l’hypertexte artistique qui vient s’y abreuver, il n’y avait pas de différence. S’il y a une tendance (artistique) qui contribue à l’air du temps (artistique) – un air qui dure du reste depuis plus de trente-cinq ans – c’est bien celle qui produit des hypertextes à partir de la culture de masse. On continuera par commodité à l’appeler pop, mais en se rappelant sur quelle confusion le label a été bâti. Une seule dénomination pour l’ensemble permet de ne pas séparer des discours que l’historiographie disjoint alors qu’ils reposent sur un présupposé commun.
Le terme Neo-Pop a ainsi justement été accolé à certaines tendances américaines des années 1980. J’avais pour ma part rapproché les Neo-Geo et des vétérans du Pop dans l’exposition Tableaux abstraits [44], où Lavier et Frize, du reste figuraient en bonne place. Une telle proximité des différentes générations pop a été comprise par les organisateurs de The Pop Project [45], une série d’expositions qui eut lieu à New York en 1988. Dans ce cadre, Brian Willis avait évoqué l’exposition emblématique des débuts du Pop Art anglais : This is Tomorrow – ce qui donnait This is Tomorrow Today ! Le sous-titre du catalogue : The Rise and Fall and Rise of Pop, quant à lui, indiquait combien le Pop se déversait, nous submergeait par vagues successives.
Le voyage toujours renouvelé au pays de la société de consommation et des mass media engendre ainsi un exotisme varié qui s’étend du quotidien aux nouvelles technologies. Il a d’abord eu lieu au pays de la mort douce du kitsch ; avec l’accélération de l’obsolescence des images et des objets, il se fait désormais dans le proche et le contemporain, « ici et maintenant ». Pour la génération des années 1980 qui a grandi bercée par cette culture de masse, il n’est même plus sûr qu’il s’agisse encore d’une autre contrée. La perte du lointain (de l’aura) est consommée. Dans la proximité vécue s’estompent le motif du scandale aussi bien que l’altérité de cette culture et de sa (non)distinction. Le Pop Art marquait pour la conscience visuelle cultivée le moment de son accès à la circulation indéfinie des signes. C’était un temps d’étonnement devant l’envahissement du monde par des signes non encore acclimatés. Vingt ans plus tard, les simulationnistes et autres Neo-Pop (chez qui on dénote une capacité comparable d’enregistrement) vivent leur naturalisation paradoxale. C’est qu’ils sont nés et ont grandi dans un monde déjà remodelé. Le paysage sémiotisé (l’aménagement du territoire) et les communications de masse constituent leur niche écologique. La simulation (une attitude) a remplacé le simulacre (qui avait encore le statut d’objet extérieur). Ce passage éclaire tant soit peu le sens de la réunion des différentes générations présentes dans l’exposition grenobloise.
Question : qu’est-ce qui fait se rejoindre l’hypotexte et l’hypertexte ?
– réponse 1 : le devenir signe de toute chose. Bertrand Lavier et le groupe Présence Panchounette donnent ici la clé : le premier comme maître des objets sémiophores, les seconds pour l’acuité avec laquelle ils ont pressenti l’égalisation du High & Low [46].
– réponse 2 : la domination de la valeur d’exposition, la visibilité. Le facteur de visibilité informe l’esprit du temps sous toutes ses formes. Il sert de lien secret à tous les artistes réunis dans ce bilan grenoblois. Comme me le confiait le critique chargé de couvrir ici même la fin des années 1980 (j’étais chargé de traiter du début !), « jamais des artistes [il parlait des siens] n’ont bénéficié d’autant de visibilité aussi rapidement à l’échelle internationale ».
Icône
À parcourir, comme nous l’avons fait, toutes les facettes de l’appareil optique, à en démonter (encore que très partiellement sans doute) les opérations, on pourrait conclure que l’exposition est un paquet bien mal ficelé. Il n’en est rien. Elle redouble merveilleusement ce qu’elle tient sous images, objets, scènes. Elle répète en son gestuel d’étalage, le devenir exposition de l’œuvre contemporaine (que recueille le mot « scènes »), ce display omniprésent, depuis les superpositions d’un Bertrand Lavier jusqu’aux transpositions scénographiques d’ambiances de récits biographiques de Dominque Gonzalez-Foerster, ou aux prestations d’un Philippe Parreno (qui dit ne réaliser ni performances, ni installations, mais des expositions, tenant ainsi cette dernière pour l’œuvre). En extrayant du continuum décennal de l’art français des monuments erratiques, elle répète l’attrait diffus de toute une génération pour le fragment allégorique. Des œuvres-expositions, elle n’en fait qu’une, et recolle pour un temps les fragments. Elle reconstruit une image à partir de tant d’autres plus ou moins boiteuses. Elle reconstitue de son miroir un corps provisoirement plein – même s’il est vrai que ce miroir s’entoure de prudence, ne se double pas d’une communication intempestive, est moins glorieux que celui des prophètes du début des années 1980, qu’il est peu mythologisant et plutôt classique en somme.
Seul le discours critique peut démonter l’appareil d’optique, y percevoir les effets de réflexion, de gauchissement, de cadrage, de profondeur de champ, de mise au point, de perspectives, d’orientation qu’il engendre. L’exposition, elle, s’en fiche. À l’heure où j’écris, il m’est bien entendu difficile de juger de sa réussite visuelle. Réussie elle fera image. Si les œuvres sont judicieusement choisies, si la mise en scène est bonne, elle aura peut-être une chance de devenir, comme l’on dit, emblématique. De quoi ? – De l’art des années 1980 vu par un commissaire faisant ses comptes en 1997, si vous voulez. Elle aura alors pleinement rempli son rôle, tenu son rang, confirmé son être d’icône.
[1] . Une critique de jugement, 1er août 1923.
[2]. Iouri Lotman, La structure du texte artistique (Moscou, 1970), trad. franç. Paris, Gallimard, 1973.
[3]. Communication orale, octobre 1996. Cette référence explicite n’est pas mentionnée dans le communiqué de presse diffusé vers le 12 décembre.
[4]. Tendances de l’art en France 1968-1978/9 : – 1. les partis pris de Marcelin Pleynet, ARC, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 13 sept. – 21 oct. 1979 ; – 2. les partis pris de Gérald Gassiot-Talabot, ibidem, 26 oct. – 5 déc. 1979 ; – 3. partis pris autres, ibidem, 14 déc. 1979 – 20 janv. 1980. La préface de Suzanne Pagé ne figure que dans les deux premiers catalogues.
[5]. Mosset s’était laissé annexer par Pleynet, et Parmentier avait cessé de peindre.
[6]. On ne peut que renvoyer ici au beau travail réalisé par les étudiants de Jean-Marc Poinsot : Une scène Parisienne, Rennes, Centre d’histoire de l’art contemporain, 1991. On consultera notamment la chronologie dréssée par Claire Legrand.
[7]. Philippe Cyroulnik, Morten Salling, Otto Teichert, présentation de l’exposition Lato Sensu – 17 artistes français, petit journal de l’exp., Mulhouse, Musée des beaux-arts, 1991.
[8]. Éric Troncy, « Punk’s not dead ! », in Documents sur l’art contemporain n° 0, Paris, mars 1992.
[9]. Cf. par exemple Jean-Yves Jouannais, « L’esthétique du fiasco », ibidem.
[10]. « Pour une esthétique relationnelle », in Documents sur l’art n° 7, Paris, printemps 1995 et n° 8, Paris/Dijon, printemps 1996.
[11]. Christelle Le Bihan, Yvan Poulain, entretien avec Yves Aupetitallot, in C’est pas la fin du monde – un point de vue sur l’art des années quatre-vingt, Rennes, Centre d’histoire de l’art contemporain, 1992, p. 73-86.
[12]. Paris, La Différence, 1986.
[13]. Nadine Descendre, « Il n’y a pas d’“art français” », in Public n° 4, Paris / Grenoble, Le Magasin, 1989.
[14]. L’art contemporain en France, Paris, 1987, p. 13.
[15] . Individualités : 14 Contemporary Artists from France, Toronto, Art Gallery of Ontario, 1991.
[16]. Liberté & Égalité – Freiheit und Gleichheit Wiederholung und Abweichung in des neueren franzözischen Kunst, Essen, Museum Folkwang, et Winterthur, Kunstmuseum, 1989.
[17] . Éric Troncy, « A Talk Show », in catalogue de l’exposition French Kiss, Genève, Halle Sud, 1990.
[18]. Thierry de Duve, « Au théâtre ce soir », in L’époque la mode la morale la passion, Paris, Centre Georges Pompidou, 1987, p. 25 sq.
[19]. Catherine Strasser, « Figures des années quatre-vingts », in 25 ans d’art en France 1960-1985, (sous la direction de Robert Maillard), Paris, Larousse, 1986.
[20]. Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, p. 37.
[21]. Christos M. Joachimides, « Achill und Hector vor den Mauern von Troja », in Zeitgeist, Berlin, Frolich & Kaufmann, 1982.
[22]. A Forest of sign – Art in the Crisis of Representation, Los Angeles, The Museum of Contemporary Art, 1989.
[23]. Jean-Marc Poinsot, « C’est pas la fin du monde ! », in catalogue de l’exposition du même nom, op. cit., p. 7.
[24]Rosalind Krauss, « Sculpture in the Expanded Field » [1978], in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Mass., The MIT Press, 2e édition, 1985, p. 288.
[25]Craig Owens, « The Allegorical Impulse – Toward a Theory of Postmodernism », in October, n° 12, Cambridge, Mass., The MIT Press, printemps 1980, 60 et 75.
[26]. Reproduite in Leo Steinberg, Other Criteria – Confrontations with Twentieth-Century Art, Oxford University Press, 1972, p. 91. Cité par Yves Michaud in « Labels » (catalogue L’époque, la mode, la morale, la passion, op. cit.).
[27]. Le mouvement, nommé ainsi par Bonito Oliva dans un article de Flash Art paru en octobre 1979, faisait pendant à l’architecture post-moderne à la biennale de Venise de 1980. Il inclut la Transavanguardia dans le maniérisme in Minori Maniere – Dal Cinquecento alla Transavanguardia, Milan, Feltrinelli, 1985.
[28]. Simulacres et simulations, Paris, Galilée, 1981.
[29]. Éric Troncy, « L’Hacienda, célèbre discothèque… », préface au catalogue de l’exposition Il faut construire l’hacienda, Tours, Centre de création contemporaine, 1992.
[30]. La fin de l’histoire et le dernier homme, trad. del’anglais, Paris, Flammarion, 1992.
[31]. La condition postmoderne, Paris, Minuit.
[32]. Titre d’une exposition au Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice en 1994, à laquelle participaient, entre autres Joseph et Parreno.
[33]. Titre d’une exposition à l’E.L.A.C., à Lyon, à laquelle participaient entre autres Christiane Geoffroy et Marylène Negro.
[34]. Titre d’une exposition à l’E.L.A.C., à Lyon. Thiery Raspail, organisateur, écrit dans la préface du catalogue : « Les 9 artistes présents n’ont d’autre point commun que celui d’être contemporains. »
[35]. Cf. Anne Rochette, « The Post-Beaubourg Generation », in Art in America vol 75 n° 6, New York, juin 1987, p. 41 sq.
[36]. Catherine Quéloz, « Une histoire vraissemblable », in catalogue de l’exposition Allen Ruppersberg, Grenoble, Le Magasin, 1996.
[37]. French Kiss, déjà citée et Surface de Réparations (Dijon, FRAC de Bourgogne, 1994-95).
[38]. Fondée en 1992. Nicolas Bourriaud, Éric Troncy et Philippe Parreno font actuellement partie du comité de rédaction.
[39]. Une idée en l’air (New York, 1980), et Il n’y a pas d’« art français », déjà citée, pour Cazal. Vilmouth est co-organisateur, avec entre autres Dominique Gonzalez-Foerster de L’hiver de l’amour (Paris, Musée d’art moderne de la Ville, 1995). Un entretien de ce dernier avec Jacques Guillot, le premier directeur du Magasin, servit de préface à l’exposition Situation, réunissant au CREDAC, à Ivry, en 1988, Joisten, Joumard et Negro…
[40]. 1995. Franck Perrin, directeur de la revue Blocnotes en était le commissaire. Y participaient entre autres Veilhan, Séchas, Bazille et Huyghe, et quelques créatures de Devautour.
[41]. Galerie de la marine (Direction des musées de Nice).
[42]. Daniel Boorstin, The Image : A Guide to Pseudo-Events in America, New York, 1994, cité d’après la trad. franç de Marie-Jo Milcent, L’Image, Paris, U.G.E., 1971, p. 267.
[43]. Pour ce type d’exercice, je me permets de renvoyer à mon « Art Worlds et Res publicita », in Art et Publicité 1890-1990, Paris, Centre Georges Pompidou, 1990, p. 478-479.
[44]. Nice, Villa Arson, 1986.
[45]. Cf. le catalogue Modern Dreams, New York, The Institute for Contemporary Art, 1988.
[46]. C’était le titre d’une exposition traitant des rapports de l’art et de la culture de masse, au MOMA, à New York en 19